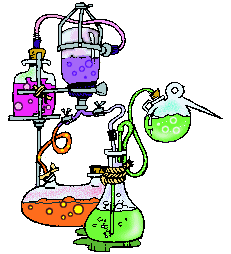Semaine 15: du 21/01 au 27/01
SA3.
Titrages acido-basiques
· Titrage
acide fort/base forte, pH-métrique et conductimétrique. Allure des courbes,
détermination du volume équivalent (dérivée, méthode de Gran), équation des
courbes pH=f(V) et σ=f(V) (notion de conductivité corrigée du facteur de
dilution). Influence de la dilution sur la courbe de pH.
· Titrage
acide faible/base forte, pH-métrique et conductimétrique. Allure des courbes,
détermination du volume équivalent (dérivée, méthode de Gran), équations des
courbes, influence de la dilution, influence du pKa.
·
Titrage
de mélange d’acides ou de polyacides. Titrages simultanés/successifs en
fonction du ∆pKa. Equation de la courbe.
·
Indicateurs
colorés.
RMN
Savoir expliquer le principe d’obtention
d’un spectre RMN (spin du noyau, levée de dégénérescence en présence de champ
magnétique B0, résonance à l’aide d’un second champ magnétique de
fréquence variable).
Intégration.
Notion de déplacement chimique
(blindage/déblindage, échelle définie par rapport au TMS).
Couplage (protons équivalents, règle des n+1, couplage avec deux protons non équivalents).
CO4 Liaison C-O
Présentation des alcools et éther-oxydes
Préparation des alcoolates et synthèse de Williamson.
Semaine 14: du 14/01 au 19/01
Titrages pH-métriques
Semaine 13: du 07/01 au 12/01
Titrages pH-métriques
Semaine 10: du 03/12 au 08/12
CO1.
Stéréochimie
· Représentation
des molécules : Cram, perspective, Newmann
· Isomérie
de constitution (chaîne, position, fonction), stéréoisomérie
(conformation/configuration)
· Stéréoisomères
de conformations : définition, notion de conformères, différence de
stabilité entre conformations (gêne stérique, origine électrostatique)
·
Diagramme
d’énergie potentielle de l’éthane et du butane.
· Représentation
du cyclohexane en chaise/bateau (perspective et Newmann). Justification de la
stabilité de la chaise par rapport au bateau. Cas des cyclohexanes mono et
di-substitué.
·
Activité
optique : définition, principe du polarimètre, loi de Biot. Espèce
lévogyre/dextrogyre.
·
Enantiomères :
définition et propriétés. Nomenclature R,S. Mélange racémique.
· Diastéréoisomérie :
définition et propriétés. Doubles liaisons (Nomenclature Z/E), cas des
molécules à deux carbones asymétriques (relation entre les différents
stéréoisomères, existence de composé méso). Nombre maximal de stéréoisomères de
configuration pour une molécule donnée.
· Dédoublement
d’un racémique : passage par diastéréoisomères, chromatographie chirale.
Notion de synthèse asymétrique.
CO2.
Liaison carbone-halogène
· Présentation
des halogénoalcanes : nomenclature, propriétés de la liaison C-X
(longueur, énergie, moment dipolaire, polarisabilité), présentation de la
réactivité (SN, E)
· Substitution
nucléophiles : SN2 et SN1. Mécanismes, stéréochimie
(notion de stéréosélectivité/stéréospécificité), profil réactionnel. Influence
du substrat, du nucléophile, du nucléofuge, du solvant.
· Elimination.
Régiosélectivité de Zaytsev. E1 et E2. Mécanismes, stéréochimie, profil
réactionnel.
· Influence
de la base, du substrat, du nucléofuge, du solvant pour E1/E2.
· ù:oço^=ç!juyè-h nCompétition
SN/E.
Semaine 9: du 26/11 au 01/12
CO1.
Stéréochimie
· Représentation
des molécules : Cram, perspective, Newmann
· Isomérie
de constitution (chaîne, position, fonction), stéréoisomérie
(conformation/configuration)
· Stéréoisomères
de conformations : définition, notion de conformères, différence de
stabilité entre conformations (gêne stérique, origine électrostatique)
· Diagramme
d’énergie potentielle de l’éthane et du butane.
· Représentation
du cyclohexane en chaise/bateau (perspective et Newmann). Justification de la
stabilité de la chaise par rapport au bateau. Cas des cyclohexanes mono et
di-substitué.
·
Activité
optique : définition, principe du polarimètre, loi de Biot. Espèce
lévogyre/dextrogyre.
·
Enantiomères :
définition et propriétés. Nomenclature R,S. Mélange racémique.
· Diastéréoisomérie :
définition et propriétés. Doubles liaisons (Nomenclature Z/E), cas des
molécules à deux carbones asymétriques (relation entre les différents
stéréoisomères, existence de composé méso). Nombre maximal de stéréoisomères de
configuration pour une molécule donnée.
· Dédoublement
d’un racémique : passage par diastéréoisomères, chromatographie chirale.
Notion de synthèse asymétrique.
CO2.
Liaison carbone-halogène (COURS
uniquement)
· Présentation
des halogénoalcanes : nomenclature, propriétés de la liaison C-X
(longueur, énergie, moment dipolaire, polarisabilité), présentation de la
réactivité (SN, E)
· Substitution
nucléophiles : SN2 et SN1. Mécanismes, stéréochimie
(notion de stéréosélectivité/stéréospécificité), profil réactionnel. Influence
du substrat, du nucléophile, du nucléofuge, du solvant.
· Elimination.
Régiosélectivité de Zaytsev. E1 et E2. Mécanismes, stéréochimie, profil
réactionnel.
Semaine 8: du 19/11 au 24/11
CC3.
Mécanismes réactionnels
· Notion
d’acte élémentaire : définition, propriétés (moindre changement de
structure, molécularité faible, ordre simple), profil réactionnel (barrière
d’énergie = Ea, coordonnée de réaction, état de transition)
·
Intermédiaire
de réaction (définition, formation)
·
Approximations
utilisées : AECD, AEQS, pré-équilibre rapide
·
Différents
types de mécanisme
o
Par
stades
o
En
chaînes (noms des différentes étapes, notion de maillon, de porteurs de chaîne,
de longueur de chaînes)
·
Représentation
des molécules : Cram, perspective, Newmann
· Isomérie
de constitution (chaîne, position, fonction), stéréoisomérie
(conformation/configuration)
· Stéréoisomères
de conformations : définition, notion de conformères, différence de
stabilité entre conformations (gêne stérique, origine électrostatique)
·
Diagramme
d’énergie potentielle de l’éthane et du butane.
·
Représentation
du cyclohexane en chaise/bateau (perspective et Newmann). Justification de la
stabilité de la chaise par rapport au bateau. Cas des cyclohexanes mono et
di-substitué.
·
Activité
optique : définition, principe du polarimètre, loi de Biot. Espèce
lévogyre/dextrogyre.
·
Enantiomères :
définition et propriétés. Nomenclature R,S. Mélange racémique.
· Diastéréoisomérie :
définition et propriétés. Doubles liaisons (Nomenclature Z/E), cas des
molécules à deux carbones asymétriques (relation entre les différents
stéréoisomères, existence de composé méso). Nombre maximal de stéréoisomères de
configuration pour une molécule donnée.
· Dédoublement
d’un racémique : passage par diastéréoisomères, chromatographie chirale.
Notion de synthèse asymétrique.
Semaine 4: du 08/10 au 13/10
AM4.
Structure des molécules – 1ère approche
·
Modèle de Lewis de la liaison covalente. Limites du
modèles (acides de Lewis, composés hypervalents, cas des métaux de transition)
·
Liaison covalente délocalisée : mésomérie.
Formes mésomères et hybride de résonance. Notion de conjugaison. Poids des
différentes formes mésomères.
·
Géométrie des molécules : méthode VSEPR ( AXnEm
jusqu’à n + m = 6). Modification des angles de liaison (liaison double,
électronégativité…)
·
Paramètres structuraux : énergie et
longueur de liaison, moment dipolaire. Polarité d’une molécule.
·
Effets électroniques : effets
inductifs et mésomères.
CC1.
Cinétique formelle
·
Définition :
vitesse de disparition/apparition d’un constituant, vitesse de réaction.
·
Facteurs
cinétiques :
o
Influence
de la température : loi d’Arrhenius. Définition et utilisation (cas où
l’on ne dispose que d’un couple (k1, k2) et (T1
et T2), et cas d’une série de données (ki,Ti)
o
Influence
de la concentration : notion d’ordre (partiel, global, initial, simple)
o
Autres
facteurs : pression partielle, radiations lumineuses, catalyseur.
·
Cas
des réactions d’ordre zéro, un ou deux (par rapport à un seul réactif). Dans
chacun des cas, établir :
o
L’expression
liant la concentration du réactif et le temps.
o
L’expression
du temps de demi-réaction
o
L’unité
de la constante de vitesse.
o
La
fonction à étudier pour vérifier l’ordre.
·
Méthodes
de détermination de l’ordre
o
Méthode
intégrale
o
Méthode
différentielle
o
Méthode
des vitesses initiales
o
Méthode
du temps de demi-réaction
o
Dégénérescence
de l’ordre
o Mélange stoechiométrique
Semaine 3: du 01/10 au 06/10
AM3.
Classification périodique
·
Aspects
historiques : Mendeleïev
·
Structure
de la classification (principe de construction, notion de période, de famille,
bloc, cas de H et He). Savoir retrouver la place d’un élément dans la
classification à partir de son Z, et vice-versa.
·
Energie
d’ionisation : définition, évolution ligne et colonne, analyse, irrégularités.
·
Affinité
électronique : définition, évolution ligne, analyse et irrégularités.
·
Electronégativité
: définition, échelle de Mulliken, évolution.
·
Rayon
atomique : définition, calcul à partir du rayon d’une OA dans le modèle de
Salter. Interprétation de l’évolution dans la classification. Rayon covalent,
métallique, ionique.
·
Notion
de polarisabilité et de pouvoir polarisant.
·
Evolution
des propriétés chimiques : pouvoir réducteur des alcalins, pouvoir oxydant
des dihalogènes, propriétés acido-basiques des oxydes de la 3ème
ligne (caractère ionique ou covalent des oxydes)
Les
trois premières lignes de la classification doivent être connues. Les numéros
atomiques des éléments de ces trois périodes ne seront pas fournies.
AM4.
Structure des molécules – 1ère approche
·
Modèle de Lewis de la liaison covalente. Limites du
modèles (acides de Lewis, composés hypervalents, cas des métaux de transition)
·
Liaison covalente délocalisée : mésomérie.
Formes mésomères et hybride de résonance. Notion de conjugaison. Poids des
différentes formes mésomères.
·
Géométrie des molécules : méthode VSEPR ( AXnEm
jusqu’à n + m = 6). Modification des angles de liaison (liaison double,
électronégativité…)
·
Paramètres structuraux : énergie et
longueur de liaison, moment dipolaire. Polarité d’une molécule.
·
Effets électroniques : effets
inductifs et mésomères.
CC1.
Cinétique formelle (Cours
seulement)
·
Définition :
vitesse de disparition/apparition d’un constituant, vitesse de réaction.
·
Facteurs
cinétiques :
o
Influence
de la température : loi d’Arrhenius. Définition et utilisation (cas où l’on
ne dispose que d’un couple (k1, k2) et (T1 et
T2), et cas d’une série de données (ki,Ti)
o
Influence
de la concentration : notion d’ordre (partiel, global, initial, simple)
o
Autres
facteurs : pression partielle, radiations lumineuses, catalyseur.
·
Cas
des réactions d’ordre zéro, un ou deux (par rapport à un seul réactif). Dans
chacun des cas, établir :
o
L’expression
liant la concentration du réactif et le temps.
o
L’expression
du temps de demi-réaction
o
L’unité
de la constante de vitesse.
o
La
fonction à étudier pour vérifier l’ordre.
Semaine 2: du 24/09 au 30/09
AM1. Atome d’hydrogène et
hydrogénoïdes
·
Spectres
atomiques : notion de quantification. Lien avec les diagrammes énergétiques
(état fondamental, excité, énergie d’ionisation).
·
Fonction
d’onde, probabilité de présence, orbitale atomique.
·
Représentation
des OA. Partie radiale (notion de rayon d’une OA) et angulaire. Schéma des OA
s, p et d.
·
Nombres
quantiques
AM2. Atomes
polyélectroniques
·
Position
du problème. Approximation orbitalaire, notion d’écran et de charge effective.
·
Nouvelles
OA, levée de dégénérescence, énergie d’une OA dans le modèle de Slater.
·
Configuration
électronique : principe de Pauli, règle de Kleshkovski, règle de Hund
(définition du paramagnétisme et du diamagnétisme).
·
Electrons
de coeur /valence
·
Configuration
des ions.
AM3. Classification
périodique
·
Aspects
historiques : Mendeleïev
·
Structure
de la classification (principe de construction, notion de période, de famille,
bloc, cas de H et He). Savoir retrouver la place d’un élément dans la
classification à partir de son Z, et vice-versa.
·
Energie
d’ionisation : définition, évolution ligne et colonne, analyse, irrégularités.
·
Affinité
électronique : définition, évolution ligne, analyse et irrégularités.
·
Electronégativité
: définition, échelle de Mulliken, évolution.
·
Rayon
atomique : définition, calcul à partir du rayon d’une OA dans le modèle de
Salter. Interprétation de l’évolution dans la classification. Rayon covalent,
métallique, ionique.
·
Notion
de polarisabilité et de pouvoir polarisant.
Les trois premières lignes de la classification doivent être connues. Les numéros atomiques des éléments de ces trois périodes ne seront pas fournies.
AM4. Structure des molécules
– 1ère approche
·
Modèle de Lewis de la liaison covalente. Limites du
modèles (acides de Lewis, composés hypervalents, cas des métaux de transition)
·
Liaison covalente délocalisée : mésomérie.
Formes mésomères et hybride de résonance. Notion de conjugaison. Poids des
différentes formes mésomères.
·
Géométrie des molécules : méthode VSEPR ( AXnEm
jusqu’à n + m = 6). Modification des angles de liaison (liaison double,
électronégativité…)
·
Paramètres structuraux : énergie et
longueur de liaison, moment dipolaire. Polarité d’une molécule.
· Effets électroniques : effets inductifs et mésomères.
Semaine 1: du 17/09 au 23/09
AM1. Atome d’hydrogène et
hydrogénoïdes
·
Spectres
atomiques : notion de quantification. Lien avec les diagrammes énergétiques
(état fondamental, excité, énergie d’ionisation).
·
Fonction
d’onde, probabilité de présence, orbitale atomique.
·
Représentation
des OA. Partie radiale (notion de rayon d’une OA) et angulaire. Schéma des OA
s, p et d.
·
Nombres
quantiques
AM2. Atomes
polyélectroniques
·
Position
du problème. Approximation orbitalaire, notion d’écran et de charge effective.
·
Nouvelles
OA, levée de dégénérescence, énergie d’une OA dans le modèle de Slater.
·
Configuration
électronique : principe de Pauli, règle de Kleshkovski, règle de Hund
(définition du paramagnétisme et du diamagnétisme).
·
Electrons
de coeur /valence
·
Configuration
des ions.
AM3. Classification
périodique
·
Aspects
historiques : Mendeleïev
·
Structure
de la classification (principe de construction, notion de période, de famille,
bloc, cas de H et He). Savoir retrouver la place d’un élément dans la
classification à partir de son Z, et vice-versa.
·
Energie
d’ionisation : définition, évolution ligne et colonne, analyse, irrégularités.
·
Affinité
électronique : définition, évolution ligne, analyse et irrégularités.
·
Electronégativité
: définition, échelle de Mulliken, évolution.
·
Rayon
atomique : définition, calcul à partir du rayon d’une OA dans le modèle de
Salter. Interprétation de l’évolution dans la classification. Rayon covalent,
métallique, ionique.
·
Notion
de polarisabilité et de pouvoir polarisant.
Les
trois premières lignes de la classification doivent être connues. Les numéros
atomiques des éléments de ces trois périodes ne seront pas fournies.